Entretien inédit pour le site de Ballast
Le premier Forum mondial antinucléaire s’est tenu à Tokyo en 2016. Le journaliste japonais Kolin Kobayashi, basé à Paris et correspondant pour Days Japan, s’y est impliqué depuis la première heure. Nous le retrouvons dans un café du centre de la capitale, qui accueillit sa troisième édition en novembre 2017 et réunit des intervenants et des militants de Russie, d’Espagne, du Niger, des deux Amériques et bien sûr du Japon. Le Forum s’acheva alors à Bure, dans la Meuse. En plus d’alerter sur les dangers intrinsèques du nucléaire, Kobayashi aspire à mettre en lumière les travailleurs exposés dans un pays où d’importants séismes sont à prévoir, alors même que ce dernier continue de compter les victimes « collatérales » de l’accident nucléaire de Fukushima en 2011. « On n’en parle pas ; autrement, on serait paniqués. »
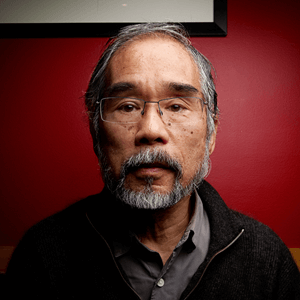
Oui. La situation était réellement chaotique car les autorités japonaises n’étaient pas du tout prêtes à affronter un accident nucléaire majeur. Le gouvernement ne pouvait pas imaginer un accident de l’ampleur de Tchernobyl. Ils n’ont pas su gérer la situation et je crois que rien n’a changé, jusqu’à aujourd’hui. La situation est la même ! C’est de toute façon ingérable, un accident de cet ordre. Mais le lobby nucléaire international essaie de montrer qu’il est capable de prendre en main un accident nucléaire et en parle comme s’il s’agissait d’un risque naturel à gérer, à l’instar d’un typhon ou d’un séisme. L’accident nucléaire majeur est compté parmi ces risques ; un parmi d’autres, en somme : ça, c’est le discours officiel. Mais c’est incomparable ! Deux ans après le 11 mars 2011, dans la ville de Sendai, un grand Symposium international a été mis en place avec les organisations onusiennes. Malgré le fait qu’il s’agisse d’un accident qui nous laisse encore aujourd’hui dans un état d’urgence, ils n’ont absolument pas parlé de Fukushima. C’est incroyable, n’est-ce pas ?
Quelle est la situation des 130 000 personnes déplacées au Japon à cause de la situation nucléaire, et qu’on invite à revenir ?
« Le lobby nucléaire international essaie de montrer qu’il est capable de prendre en main un accident nucléaire et en parle comme s’il s’agissait d’un risque naturel à gérer. »
On a 100 000 personnes qui sont déplacées à l’intérieur et à l’extérieur du département de Fukushima. Pour quelles raisons les autorités japonaises décident-elles de faire revenir ces réfugiés ? C’est un problème social et économique extrêmement important. Ils menacent de couper les subventions aux réfugiés qui sont partis ailleurs et qui ne reviendraient pas. Les autorités essaient de dire : finalement, les conséquences radioactives ne sont pas si importantes que ça, vous pouvez revenir, il faudra juste faire attention à ne pas manger d’aliments contaminés, à ne pas passer dans tels ou tels quartiers un peu contaminés ; ainsi, vous pourrez continuer à vivre. Mais la population vivait majoritairement de la terre ; les gens étaient paysans et agriculteurs, le département était l’un des plus importants centres agricoles… Il y a le village d’Iitate : c’était un foyer de l’agriculture biologique ! Juste après l’accident, tout a été contaminé. Un documentaire est d’ailleurs consacré à cette question : Iitaté, chronique d’un village contaminé, du réalisateur Doi Toshikuni. On ne peut pas nettoyer la forêt, la montagne ou les champs ; on ne peut pas tout raser, soulever 30 centimètres de terre et la mettre ailleurs. Alors on nettoie un peu comme ça, à la manière d’une salutation diplomatique, mais pas plus.
C’est une manière pour le gouvernent de minimiser la catastrophe ?
Bien sûr. Il ne faut pas laisser paniquer la population et de ne pas créer une crise économique.
Cela prend-il auprès de la majorité de la population ?
Il y a quelques agriculteurs particulièrement attachés à leur terroir. Certains, désespérés, se sont suicidés. D’autres essaient de collaborer avec des scientifiques afin de minimiser la contamination radioactive et remettre leurs champs en état. Des agriculteurs âgés ne peuvent plus vivre dans une maison préfabriquée d’en moyenne 29,7 m² prêtée par l’État ; ils sont tellement traumatisés… Ceux qui avaient des maisons de famille appartenant à leurs parents, à leurs grands-parents, accueillant leurs enfants et petits enfants, ceux-là se retrouvent tous dans un foyer. Résignés et conscients que, même atteints de maladies cancérigènes dues à la radioactivité, ils n’ont plus longtemps à vivre. Ceux-là se résignent, et reviennent.

[25 février 2016, Okuma, Japon (Christopher Furlong | Getty Images)]
Ils savent qu’ils ne vont donc pas léguer ces terres à leur famille.
La majorité des agriculteurs, conscients de tout cela, savent très bien qu’après leur génération, ce sera terminé. Les jeunes ne reviendront plus.
Que peuvent-ils transmettre aux générations futures ?
Les jeunes ont peur de subir la contamination et les familles avec enfants ne veulent pas revenir. Alors les villages, même s’ils étaient déjà petits — 6 000 personnes vivaient à Iitaté avant l’accident, 400 maintenant —, sont constitués en majorité d’une population de personnes de plus de 65 ans qui, une fois morts, n’auront personne derrière eux. Hasegawa Kenichi était fermier ; il a choisi de revenir avec sa mère de plus de 80 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer pour continuer à vivre ailleurs que dans une baraque préfabriquée. Il est tout à fait conscient que son village et sa maison sont complètement contaminés. Mais il s’y est résigné. C’est assez tragique.
Comment gérer cette contradiction centrale entre l’urgence sécuritaire de la centrale et la protection des travailleurs livrés à son exposition ?
« Il est tout à fait conscient que son village et sa maison sont complètement contaminés. Mais il s’y est résigné. »
En réalité, ils ne les protègent pas. L’efficacité économique est prioritaire. Les travailleurs qui sont dans des zones d’irradiations fortes, des zones à risques, ne sont pas les salariés officiels de TEPCO [multinationale japonaise et, avant sa nationalisation, plus grand producteur privé mondial d’électricité, ndlr] : on fait appel à des sous-traitants. En France également, il y a des salariés « officiels » qui ne vont pas — sauf cas exceptionnels — dans des endroits dangereux. Au Japon, il y a dix étages de sous-traitance. TEPCO demande à une société générale de gérer l’ensemble des étages. Et, au final, l’entreprise qui se trouve au dernier étage n’a aucun contact avec TEPCO. La gestion et le contrôle de la santé des travailleurs qui travaillent actuellement à Fukushima Daiichi — 6 000 personnes, tous les jours ! — ne sont aucunement rationnels ni convaincants. Personne ne prend en charge cela.
Sont-ils soutenus par des organisations syndicales ?
Les syndicats officiels liés à Tepco sont complètement pro-nucléaires — comme ici, en France. Le syndicalisme existe peu dans des entreprises de moins de 50 personnes. Il y a bien une association de soutien aux travailleurs nucléaires (il s’agit en fait de plusieurs associations regroupées pour former une association solide1) qui entre en contact avec eux et leur fournit un carnet pour documenter leur carrière, dans lequel ils doivent reporter les postes qu’ils ont occupés, pendant combien de temps, à quels endroits ils sont passés, combien de doses reçues, etc. Ce carnet est utile pour archiver leur état de santé. Normalement, c’est aux autorités japonaises de le fournir à tous les travailleurs, même à ceux qui ne travailleront que dix jours : c’est utile sur le long terme. On sait que certains cancers se déclarent au bout de 30 ans ; après Hiroshima, des cancers liés aux radiations se sont déclarés après un demi-siècle.

[Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (Christopher Furlong | Getty Images)]
Il n’y a pas d’examens médicaux obligatoires ?
L’association propose ce carnet déclaratif car les patrons des petites entreprises sous-traitantes demandent aux travailleurs temporaires de ne pas révéler les doses réelles reçues. Les salariés le savent, et savent aussi qu’en déclarant le chiffre de doses réelles ils ne pourront pas travailler le jour suivant — puisque son seuil de radiation est dépassé. L’exposition va dépendre des zones où ils seront envoyés. Si untel est envoyé dans une zone très contaminée, il pourra travailler d’une traite seulement une heure, voire dix minutes par jour ; d’autres, qui font des travaux de décontamination dans les villages, peuvent travailler plus longtemps. Ils doivent faire des coupures plus ou moins contrôlées. Ceux qui ont besoin d’argent, comme les travailleurs journaliers, camouflent et magouillent donc les chiffres. Vous avez dû entendre parler des mafieux japonais, les Yakuzas, qui démarchent pour trouver des travailleurs précaires prêts à mourir…
Ces travailleurs se déclarent « prêts à mourir » ?
« Ceux qui ont besoin d’argent, comme les travailleurs journaliers, camouflent et magouillent donc les chiffres. »
Non, mais ils savent que c’est un risque à prendre. Ce sont des travailleurs précaires qui s’entassent dans certains quartiers populaires et cherchent tous les jours du travail. Ces gens-là sont malades physiquement ; les missionnaires de sous-traitants, les Yakuzas, proposent beaucoup d’argent contre le fait d’être « prêts à mourir ».
L’opinion publique japonaise est-elle correctement informée du sort des travailleurs du nucléaire ?
Officiellement parlant, les Japonais ne sont de toute façon pas informés ; ça reste une zone invisible, sauf pour les militants, les chercheurs et ceux qui s’intéressent d’eux-mêmes à ces problèmes. Le reste de la population n’est pas au courant. Mais des scandales éclatent parfois ça car cela concerne également les Yakuzas et les embauches illégales, sans fiches de salaire officielles, etc. Cela reste de l’ordre du fait divers social, comme il y en a tous les jours : ça passe et on oublie.
Un fait divers et jamais un problème économique et structurel ?
Voilà.
À combien s’élèvent les salaires proposés aux travailleurs ?
C’est flou. La société qui embauche prélève une marge salariale : au bout des dix étages, la marge prélevée devient importante et le salarié touche à peine plus que le SMIC2. L’État avait promis une subvention spéciale pour les travailleurs du nucléaire mais cet argent a été totalement absorbé par les entreprises. C’est illégal. Une prime qui dépendait de l’endroit où travaillait la personne (700 à 800 euros par mois).

[Un employé de TEPCO sur le site de la centrale de Fukushima, le 10 février 2016 (AFP | POOL | Toru Hanai]
L’État japonais s’est donc servi de l’argent des impôts pour engraisser des entreprises sous-traitantes et sous-payer des individus ?
Oui.
Sans mouvement de contestation ?
C’est comme en France ! La grande majorité des gens sont pris en otage par cette idée reçue que, sans le nucléaire, notre vie et notre civilisation moderne ne fonctionnera plus, qu’il n’y aura pas assez d’énergie pour les hôpitaux, les écoles…
Le Japon avait réagi en fermant, pour un temps, toutes les centrales…
Avant cela, le Japon était couvert par le nucléaire à hauteur de 35 %. On est loin des 75 % de la France. Il est plus facile de le convertir en électricité conventionnelle, fioul, charbon, hydro-énergie…
Quels liens économiques existent entre l’ingénierie française et japonaise ?
« Le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont le recto-verso d’une pièce de monnaie : il n’y a pas de différence, c’est une continuité. »
Le Japon avait depuis le début des années 1970 une convention de coopération avec la France. S’y échangent des savoirs-faire, notamment au sujet des réacteurs. Les Japonais travaillent bien davantage avec l’ingénierie américaine mais le lobby industriel nucléaire français a commencé à être plus présent — notamment sur la question du retraitement. Il y a une usine de retraitement au Japon, celle de Rokkasho, qui est entièrement de technologie française. C’est pour ça qu’Areva y était présent : pour échanger mutuellement des technologies. Il y a un lien fort actuellement parce que le Japon veut conquérir la potentialité du nucléaire militaire pour être élu comme membre du Conseil de sécurité. Sans tête nucléaire, on est balayés ! Les membres du club sont liés au nucléaire, donc ce sont des liens forts. Actuellement, ASTRID est un nouveau projet de quatrième génération des réacteurs ; c’est le prolongement de Superphénix. C’est une invention franco-japonaise. Les Japonais avaient un surgénérateur de prototype Monju qui a raté — comme Superphénix —, mais ils veulent continuer d’investir.
Superphénix était supposé recycler le nucléaire appauvri utilisé par les centrales principales pour recréer de l’énergie…
Ils fabriquent des combustibles Mox en mélangeant du plutonium puis recyclent à chaque fois ce plutonium pour refabriquer du Mox et en remettre dans le réacteur. Ça, c’était le plan écrit sur la table. Mais ça ne fonctionne pas ! En France, c’est aussi un problème puisque Superphénix ne marche plus. On n’a plus besoin de faire un retraitement. La raison d’être de l’usine de la Hague est remise en cause. Que faire, alors ? Pour le lobby industriel nucléaire, il faut avancer dans cette direction en disant que le plutonium n’est, au fond, pas destiné au nucléaire militaire mais sera utilisé pour la paix ! Le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont le recto-verso d’une pièce de monnaie : il n’y a pas de différence, c’est une continuité. Le premier réacteur nucléaire inventé pour faire des bombes atomiques françaises a été développé, non démocratiquement, sur l’usage civil de toutes les centrales nucléaires. Puis les Français ont expérimenté le type américain, pour revenir à leur propre technologie. Malgré les différences techniques entre nucléaire militaire et civil, ils reposent sur le même principe : la fission est contrôlée dans une centrale alors qu’on laisse volontairement dépasser une masse critique dans une bombe atomique.

[Site de stockage de Tomioka, dans la préfecture de Fukushima (Toru Hanai | Reuters)]
On parle d’un élément chimique plus accessible que l’uranium, le thorium, comme d’un possible « nucléaire propre » et plus éthique. Qu’en est-il ?
Il est dit qu’avec le thorium il y aurait moins de pollution. Mais il y a toujours un déchet qui reste et on n’a pas de solution pour le déchet du thorium ! C’est comme à Bure, où l’on enfouit des déchets à 500 mètres en sous-sol. Mais imaginons que des tunnels se cassent, qu’il y ait des explosions (comme ce fut le cas aux États-Unis il y a 60 ans, et on n’en parle pas) qui génèrent une grande contamination… La question du déchet nucléaire reste la plus importante car elle est sans solution. Le Japon est un pays tellement sismique qu’il n’y a pas d’endroit solide pour cacher de tels déchets ! Ce n’est pas comme en Finlande. Et si le magma de notre planète bouge… Pour le moment, n’ayant pas vraiment de solution, la plus raisonnable reste de stocker à la surface et de surveiller.
En 2015, on dénombrait 700 000 tonnes de déchets nucléaires autour de la centrale de Fukushima Daiichi…
« Dans un pays libéral et capitaliste comme le Japon, comment voudriez vous embaucher 800 000 personnes pour faire un sarcophage autour de trois réacteurs ? »
On se trouve dans une situation très précaire. Dans les trois premiers réacteurs de Fukushima Daiichi, il y a des piscines au sommet des bâtiments. C’est une construction de style américaine : ils n’ont pas créé une structure adaptée à un pays comme le Japon. Après le séisme, l’étanchéité des piscines s’est fragilisée. Et il y a 1 500 blocs de combustibles qui sont stockés et dont on ne sait pas quoi faire. Il aurait fallu creuser un trou et les mettre dans le sol, dans un endroit sûr, mais l’accident de Fukushima a généré une radioactivité si forte qu’on n’a pas encore de robot capable d’effectuer ces tâches — et de loin ! Les travailleurs du nucléaire ne peuvent pas aller dans ces zones : on ne peut rien y faire. En cas de nouveau séisme à cet endroit, il faudra, comme le disait Naoto Kan, évacuer les populations de la région de Fukushima et de celle de Tokyo. Comment ferait-on, techniquement et économiquement ?
Pourtant, un autre séisme est annoncé dans les vingts années à venir…
On vit vraiment dans la folie… On n’en parle pas ; autrement, on serait paniqués. À Fukushima Daiichi, la radioactivité continue de se diffuser car il n’y a pas de confinement. Ce qui a été accompli à Tchernobyl l’a été au détriment de combien de travailleurs morts ? Entre 500 000 et 800 000 personnes ont travaillé et sont mortes ou tombées gravement malades pour cimenter. Et soyons clair : c’est grâce à eux que l’Europe a été sauvée ! Mais c’était l’époque de l’Union soviétique, qui pouvait ordonner au peuple de venir « aider ». Dans un pays libéral et capitaliste comme le Japon, comment voudriez vous embaucher 800 000 personnes pour faire un sarcophage autour de trois réacteurs ?
Serait-ce souhaitable ?
On ne peut pas exiger cela…

[Un bateau et des déchets abandonnés, à Namie, février 2015 (Toru Hanai |Reuters)]
Y a‑t-il eu des études effectuées sur la faune et la flore autour de Fukushima ?
« Le risque zéro n’existe pas », entend-on chez tous les officiels des organisations internationales. Il y a des scientifiques qui ont apporté la preuves de malformations dans les gènes de plantes, de papillons, d’animaux — de même qu’à Tchernobyl, dont il existe des études poussées. Celles-ci devraient être reconnues internationalement mais le lobby nucléaire domine le débat et affirme qu’il n’y a pas de victimes de la radioactivité. C’est le discours qu’on entend au Japon.
Vous êtes impliqué dans l’organisation du Forum social antinucléaire : c’est en effet assez rare que soient réunis au même endroit différents acteurs sur ces questions…
Dans l’opinion générale de la population française et japonaise, il est dit que c’est une question purement scientifique et technique, une affaire de changement de cap énergétique. Mais, je le redis, la question du nucléaire est inséparable de la question militaire et civile. Il faut vraiment saisir le nucléaire dans sa globalité. Dès qu’il y a un accident majeur, il y a des conséquences énormes sur la santé, l’économie, la politique et la société : il faut comprendre l’ensemble des phénomènes. Pour discuter de cette globalité, il n’est pas suffisant de faire seulement une conférence antinucléaire pour parler d’un côté de la sureté nucléaire et de l’autre des déchets. Il faut parler de l’ensemble des problèmes. La structure du Forum social mondial permet d’aborder toutes les questions scientifiques, sociales, économiques et politiques : il tend à créer un réseau international afin de globaliser les contestations des populations citoyennes, des militants et des scientifiques pour dire qu’il est inacceptable de continuer avec le nucléaire.
Entretien réalisé aux côtés de l’équipe de Radio parleur, qui a réalisé ce reportage à Bure.
Photographie de bannière : Christopher Furlong
Portrait de vignette : Cyrille Choupas |Ballast
- L’Association de soutien pour éviter l’irradiation professionnelle.[↩]
- En 2015, le salaire horaire minimum était à Tokyo de 6,9 € et à Okinawa de 5,4 — la moyenne nationale se portant à 6,2. En 2018, le salaire mensuel moyen est de 2 161,49 €.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre entretien avec Michaël Ferrier : « Fukushima, c’est une situation de guerre », octobre 2017
☰ Lire notre article « Sahara algérien — des essais nucléaires aux camps de sûreté », Awel Haouati, juin 2017
☰ Lire notre article « Bure réenchante la lutte antinucléaire », Gaspard d’Allens, juin 2017
☰ Lire notre entretien avec Jean-Baptiste Comby : « La lutte écologique est avant tout une lutte sociale », avril 2017
☰ Lire notre entretien avec Nicolas Lambert : « Le public, c’est un autre mot pour dire le peuple », octobre 2017
☰ Lire notre entretien avec Razmig Keucheyan : « C’est à partir du sens commun qu’on fait de la politique », février 2016

